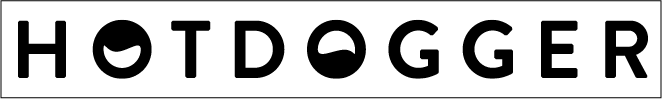SURF FOREVER
« Je surferai jusqu’à ma mort ». Que les jeunes le veuillent ou non, les quinquas et même les sexagénaires sont toujours au line-up. Et si l’on se fie aux dernières études sur le sujet, ils ne sont pas prêts de passer la main, et encore moins de disparaître des spots. Si Oscar Wilde disait que « la vie n’est qu’un mauvais quart d’heure composé de moments exquis », il semblerait bien que le surf, pour celles et ceux qui l’ont adopté, soit l’un des meilleurs moyens de rendre notre passage sur Terre plus agréable. Oui, la dévotion dévorante que suscite cette passion s’apparente à un contrat éternel, transcendant l'âge et défiant les limites du temps.
Extrait de l’article paru dans le 29ème Hotdogger (été 2024).
Par Marc-Antoine Guet.
Kelly Slater s’est imposé comme l’un des sportifs à la longévité la plus impressionnante. Ici, cet hiver à 51 ans, maîtrisant le spot de Pipeline (Oahu, Hawaii) avec une aisance inentamée. De quoi laisser aux quadras l’espoir de progresser encore un peu ? Photo : Ryan Miller.
Si vous surfez depuis déjà des années de pratique assidue, que vous soyez jeune ou âgé de quelques printemps de plus, le surf continue probablement de vous tarauder. Les vagues, mystérieuses et capricieuses, ont toujours été le sanctuaire des esprits libres et des âmes indomptables. Alors que les spots sont de plus en plus saturés, autant de surfeurs de plus de quarante ans continuent de chevaucher les vagues avec la même ferveur inaltérée. C’est sans aucun doute dans le secret des vagues que réside la clef de cette passion éternelle. Shaun Tomson, Tom Curren, Occy, Gerry Lopez, Tom Carroll, Michael Ho, Kelly Slater… les meilleurs surfeurs de l’histoire n’ont jamais semblé vouloir raccrocher les dérives pour de bon. Et surtout ceux qui ont débuté dans les années 1970 avec le shortboard pourtant plus exigeant. La retraite professionnelle oui, avec plaisir même. Arrêter de surfer, jamais. Cela peut en partie s’expliquer par « cette fascination universelle de l’homme pour la mer et en particulier pour la vague », comme le décrit notre collaborateur Hervé Manificat lors de la conférence Hotdogger « Le surf, éternelle jeunesse ? » qui s’était tenue au musée de Guéthary en 2017 dans le cadre des journées du patrimoine. : « Jacques Mayol par exemple, partait du principe que nous étions des amphibiens, que nous vivions dans l’eau, que la vie y était apparue et que nous avions une mémoire aquatique que l’on pouvait réveiller à travers l’apnée et certains exercices. Il parlait de “delphinisation” de l’être humain et que quelque part, l’Homme venant de l’eau, c’était normal qu’il cherche à y retourner. C’est aussi un proverbe hawaiien que Kahanamoku disait : “Ma famille croit que nous sommes issus de l’océan et que nous y retournons.” L’Homme a toujours eu cette fascination de la mer, au-delà du surf, qui de tout temps a intéressé les poètes, les peintres et les artistes. On parle chez les Hawaiiens du “He’enalu”, qui est la glisse sur les vagues. Mais le terme “nalu”, désigne aussi le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus avant sa naissance. Là aussi, ce n’est pas innocent si des civilisations tournées vers l’océan utilisent les mêmes termes pour parler des vagues ou du liquide dans lequel la vie voit le jour. C’est extrêmement symbolique. Mais il y a plusieurs écoles. J’ai cité Jacques Mayol, mais Joël de Rosnay parle de sociétés de rapports de flux en opposition de rapports de force. Gerry Lopez dit quant à lui que le surf est une leçon de vie, une forme d’existence. C’est quelque chose qui parle à n’importe quel être humain normalement constitué, même s’il n’est pas surfeur car ça appelle à quelque chose d’interne et de profond. »
Tout ça suffirait-il à expliquer pourquoi les surfeurs ne souhaitent pas raccrocher ? Peut-être. Mais ce n’est pas l’unique raison. Pour Christophe Guibert, professeur des universités en sociologie et auteur notamment du livre Les Mondes du surf, Transformations historiques, trajectoires sociales, et bifurcations technologiques, le surf « est une activité plurielle et renvoie à une multitude d’imaginaires, de pratiques, de représentations et de sens, et chacun y trouve un peu son compte. Si l’on prend l’exemple du tennis, il s’agit d’un sport principalement pratiqué en club et orienté vers l’entraînement et la compétition et, dès que l’on commence à perdre ou à diminuer physiquement, on peut changer d’activité. Beaucoup de travaux sociologiques analysent ces bifurcations au sein des carrières sportives : des joueurs de tennis vers le golf par exemple, dès qu’ils vieillissent ou diminuent physiquement. À l’inverse, on peut penser le surf bien évidemment à travers une modalité exclusivement tournée vers la performance et la compétition, mais on peut aussi le penser comme un sport qui nous rapproche de la nature. Pour d’autres, il va permettre la découverte, les voyages. Et pour d'autres encore, c'est un loisir qui permet d'entretenir son corps. Les surfeurs les plus âgés sont davantage concernés par cette approche hygiéniste. Mais on peut aussi aborder le surf via son côté culturel voire son côté supposé contre-culturel. Il y a beaucoup d’univers et de systèmes de représentations parfois contradictoires qui définissent le surf. Chacun y trouve un peu ce qu’il veut et y trouve le sens qu’il souhaite. On peut néanmoins facilement passer d’une vision de voir le surf à une autre. C’est en ce sens une pratique qui permet de tenir dans le temps pour certains sans doute toute au long de leur vie, contrairement à d’autres sports, et ce, pour des raisons physiques ou de sens. »
La psychologie du sport a trouvé un terme pour cette étape de vie très appréhendée : la « petite mort ». Et chez les sportifs pros, il est intéressant de remarquer que même si cette dernière peut intervenir à différents moments de leur carrière, le traumatisme est réel. Ils doivent accepter cette première mort avant de renaître. On se souvient par exemple du footballeur Michel Platini qui avait déclaré au moment de sa retraite, qu’il était mort à 32 ans, le 17 mai 1987, date importante qui correspond à son dernier match de football professionnel. Dans le surf, le cas de Kelly Slater est emblématique. Avec onze titres de champion du monde, l'Américain, meilleur surfeur de l'histoire de la discipline, ne semble (pas encore) avoir fait le deuil de sa première vie et, année après année, continue, à 52 ans, de parcourir le globe pour le compte de la WSL, comme s’il y avait chez lui, cette envie inexorable de repousser encore et encore ce moment tant redouté des sportifs professionnels. Pourtant, être sur le Tour aujourd’hui demeure très exigeant même quand on voyage en première classe. Avec un calendrier bien rempli, être sur le Tour aujourd’hui, est plus souvent synonyme d’heures interminables passées dans les halls d’aéroports, les taxis et les hôtels en tout genre, que dans le tube. Toujours loin de sa famille, de ses amis, et de ce que l’on construit en tant qu’Homme. Kelly n’a plus rien à prouver, pourtant, il semble toujours animé par cette même envie de vouloir écrire encore un peu plus sa légende face à des surfeurs qui, pour certains déjà, pourraient être ses enfants. D’autres, comme Julian Wilson ou plus proche de chez nous Jérémy Florès, ont dit stop au moment où leur vie de famille a pris le pas sur la fougue de la compétition qu’ils ont pu avoir en se lançant dans ce métier. L’arrivée d’enfants et le mariage font réfléchir et redéfinissent les priorités. Pour les hommes comme pour les surfeuses qui sont en plus toujours moins bien payées que leurs pairs masculins.
Jérome Daret, entraîneur des champions du monde et des champions olympiques de rugby à sept, est venu samedi 28 septembre motiver l’équipe de France de surf Masters qui va s’envoler pour les championnats du monde au Salvador mi-octobre.
De gauche à droite : Ugo Benghozi, 47 ans, du LouSurfou Surf Club, Guadeloupéen d'origine plusieurs fois sélectionné en Équipe de France Open.
Corinne Errecart, 61 ans, du Anglet Surf Club de retour à la compétition après des années d'absence.
Xénia Goffaux, 54 ans, du Mimizan Surf Club, qui après plusieurs sélections en Équipe d'Allemagne se voit qualifiée pour la première fois en Équipe de France.
Olivier Salvaire, 53 ans, du Mimizan Surf Club, plusieurs fois sélectionné en Équipe de France participera à ses septièmes WMSC en tant que capitaine.
Jérome Daret.
Éric Graciet, 62 ans, des Dauphins Biarrots Surf Club, le plus connu, le plus titré et le plus expérimenté de l'équipe participera à ses quatrièmes WMSC, lors des derniers en 2013 il avait terminé à la quatrième place.
Marie Pierre Abgrall, 50 ans, du Hossegor Surf Club qui fut la toute première française à intégrer l’élite mondiale sur le tour professionnel.
Jacques Lajuncomme, président de la Fédération Française de Surf.
Et pourtant, même lorsqu’ils abandonnent la compétition, il est indéniable qu’ils continueront de surfer pendant encore des années. Car le surf, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n'est pas une démarche aussi individualiste que la pub nous l’a vendu. C’est aussi une communauté. Un lien social qui transcende les générations où chacun demande à l’autre quotidiennement s’il a vu les vagues. Un des derniers bastions où les plus anciens partagent la ligne de crête avec les plus jeunes. À l’heure où les populations vivent cloisonnées dans leurs couloirs de nage, le surf offre un magnifique exemple de transmission entre générations. Un des derniers endroits également où les vétérans sont respectés et où l’héritage se transmet. Pour le sociologue Christophe Guibert : « Il y a un profit symbolique quant au fait de maintenir la pratique du surf passé un certain âge. Symboliquement c’est profitable de dire qu’on va toujours au peak et qu’on passe toujours la barre face à des jeunes de 20 ans. Et il ne faut pas oublier non plus que derrière le mot surf, il y a des méthodes d'engagement par le corps très différentes. Ce n’est pas la même chose de surfer deux mètres à la Gravière en shortboard qu’un mètre en mini malibu à la Côte des Basques. Oui dans le surf on peut durer, mais c’est aussi parce qu’on peut s’adapter à des conditions et modalités de pratiques qui correspondent à nos compétences et nos performances corporelles, qui, par nature, déclinent avec l’avancée en âge. » Ce qui n’est pas forcément le cas dans d’autres sports. Mais de ce point de vue, le surf ne serait-il pas alors, dans beaucoup de civilisations, vu aussi comme un rite de passage vers l’âge adulte ? Hervé Manificat, lors de notre conférence, en est persuadé. « Tout d’abord, l’image jeune du surf qui lui est accolée est très récente. Elle est due essentiellement à l’évolution des matériaux. Les planches d’avant la Seconde Guerre mondiale étaient extrêmement lourdes et empêchaient tout enfant et une bonne partie des femmes de se frotter au surf. Au départ, le surf était une activité masculine. Pour y arriver, notamment chez les Hawaiiens, cela passait par toute une éducation qui démarrait dès la naissance. Les enfants allaient à l’eau dès leur plus jeune âge. On les laissait se débrouiller et s'accoutumer avec une progression. Au début, ils jouaient au bord, puis, ils prenaient des petites vagues avec des païpos et des belly-boards (des petites planches sur lesquelles on se tenait couché). Enfin, vers l’âge de quatorze ans, dans les civilisations polynésiennes, on pouvait s’aventurer au pic, là où l’on trouvait les surfeurs confirmés sur de vraies vagues. Effectivement, il y avait là une progression et une forme de rite initiatique qui permettait d’accéder ensuite au panthéon des surfeurs reconnus avec une hiérarchie très marquée, notamment chez les Hawaiiens.
…/…
Bernard Doridant ici en 2015 à l'âge de 77 ans à Parlementia. Photo : Sylvain Cazenave.