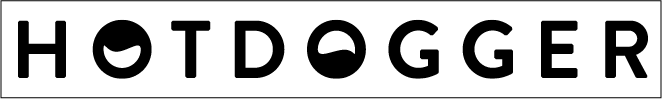DES CONGÉS PAYÉS AUX PLAGES PAYANTES : LA FIN D'UNE ÉPOQUE
Article publié dans le 26ème Hotdogger (automne 2023). Mis à jour le 22 août 2024 (mentions).
Avec les confinements successifs, une épidémie d'une autre nature a gagné les élus et les fonctionnaires du littoral français : la fièvre réglementaire. Sens interdits, places payantes à des prix exorbitants, quotas dans les calanques, chasse aux vans et éloignement jusqu'à l'absurde de parkings conduisent à privilégier ceux qui habitent dans l'immédiat voisinage des plages, pourtant un bien commun en droit français. Réaction à la surfréquentation des saisons 2021 et 2022 dûe à la pandémie et à la crainte ou l'impossibilité de voyages en dehors du continent, cette tendance n'a pas l'air près de retomber. D'Etretat à Martigues, l'accès public au littoral français se restreint inexorablement au profit des accès privés. Alerte à Malibu ?
Par Erwann Lameignère.
Elle avait l'air sympa. Certains avaient envie d'y croire puisque seuls comptaient leurs besoins sportifs. Elle était une erreur absolue. En droit d'abord. Et historique ensuite. La plage dynamique, rappelez-vous c'était cette proposition concoctée dans les cabinets de conseil grassement payés lors de la crise sanitaire pour permettre à ceux qui gigotent d'aller s'aérer face à la mer lors des nouveaux confinements de l'hiver et du printemps 2020. Qu'importe qu'on puisse prendre une bonne bouffée d'embruns assis ou allongé, qu'importe que les handicapés, les vieux ou les personnes en surpoids en étaient objectivement exclus, qu'importe que certains surfeurs s'étaient même proposés pour réguler le littoral parce que eux, ils savent (une milice de la plage, et puis quoi encore ?). Pour cette rupture d'égalité manifeste, les maires et les préfets s'écharpaient parfois à faire respecter un ordre balnéaire là où, normalement, on oublie tout (dans le respect d'autrui bien sûr) et semblent en avoir gardé le goût de la régulation des flux. Car au virus succédait une nouvelle maladie : le surtourisme. Et bien sûr, comme les outils rutilants de la régulation des masses n'avaient parfois qu'à peine servi, il fallait leur trouver une nouvelle application que l'on pourrait justifier par toutes sortes de causes, de la protection de l'environnement (les quotas) au besoin de financer la surveillance des plages (comme le maire d'Anglet l'a répondu au propriétaire du surfshop Waïmea dans un courrier relatif aux parkings payants). Et, parfois, avec les meilleures intentions du monde. Mais comme on le sait, l'enfer en est pavé. Alors exit les petits paradis ?
Ainsi les calanques entre Marseille et Martigues dans les Bouches-du-Rhône, les îles de Porquerolles dans le Var, Lavezzi en Corse ou de Bréhat en Bretagne ont instauré des quotas (pour certaines par QR code) pour limiter les dégradations faites à ces trésors naturels lors de la haute saison. En Normandie, c'est Etretat qui s'alarme des hordes de touristes qui déferlent sur ses falaises et qui accentueraient leur érosion en les piétinant. Non loin, le Mont-Saint-Michel est depuis longtemps uniquement accessible par navette. Deviendra-t-il un modèle pour bien des communes du littoral ?
Depuis 2021, la loi permet à un maire de limiter la fréquentation d'un espace protégé pour des raisons écologiques si sont entreprises des études d'impact des activités humaines sur la nature (lire La nature, bientôt sur réservation ? in Océan n°2, éditions Ouest France). De manière générale et en dehors de ces zones particulièrement protégées, le littoral français fait partie du Domaine Maritime Public et relève donc de l'état et ce, depuis la grande ordonnance de la Marine de 1681 de Colbert. C'est dans cet esprit que la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » interdit aux propriétaires de parcelles proches du trait de côte de construire à moins de cent mètres du rivage. Il s'agit de lutter contre les projets pharaoniques et les tentatives de privatisation (on se souvient de l'affaire des paillottes corses détruites à la hussarde par des gendarmes sur ordre du préfet en 1999). Ainsi, les plages privées, même si certaines demeurent des concessions historiques dans le Sud-Est, sont particulièrement mal vues sur le reste du littoral français où la plupart des cabanes doivent être impérativement démontées. La France n'est clairement pas la Californie, où l'accès à la plage peut être privatisé par d'énormes quartiers clos et sécurisés comme à Malibu, ni l’Italie où le gouvernement de Giorgia Feloni rechigne à se mettre en conformité avec le droit européen pour non-respect de la concurrence dans l'attribution des plages privées. Pourtant, c'est aux abords de ce littoral que semble se jouer l'accès libre et démocratique que seule la voiture permet en l'état des transports publics dans ces zones, qu'on soit surfeur pour y apporter du matériel ou en famille avec des enfants en bas âge. Car le vélo cargo c'est meilleur pour la planète, mais ça a ses limites pratiques. Et si tout le monde y a recours, il faudra une sacrée place pour se garer.
Les limites des plages en pleine ville
Loin d'être une zone naturelle protégée bien qu'admirée pour ses plages légendaires qui semblent faire corps avec son architecture exhubérante, Biarritz a dû appréhender les foules estivales depuis longtemps. C'est son histoire de petit village de pêcheurs de baleines devenu à la fin du XIXe siècle une station balnéaire. Mais il est désormais loin le temps où les surfeurs de la Grande Plage de Biarritz se garaient le long du parapet en mode foutraque et punk – leur fameuse murette – et se changeaient à vingt mètres du sable. Ils se sont vus offrir un local – en sous-sol et mitoyen du parking enterré – pour entreposer leur matériel lors de la suppression du parking et la création des jardins en 1992. Même si d'évidence, ils ont préféré migrer vers les Algeco de la Marbella plus au sud, des installations défendues bec et ongle par les surfeurs locaux lorsque la précédente équipe municipale avait souhaité réaménagé à nouveau leur territoire.
Tout à côté, probablement un jour reliée par un chemin du littoral lorsque l'érosion aura fait son œuvre, se trouve la Côte des Basques dont la falaise déjà bétonnée et contenue par des escaliers avait été « sauvée » d'un projet de parking, il y a une dizaine d'années.
La célèbre plage demeure pourtant l'une des plus fréquentées de France et pas seulement pour les nombreuses écoles de surf qui se partagent le line-up où est arrivée la première planche de surf en 1956. Pour sa perspective photographique indispensable aux réseaux sociaux diront les esprits moqueurs. Les opposants au projet, pour beaucoup d'entre eux, étaient des résidents biarrots qui ont tout le loisir d'aller surfer ou se baigner à pied. Il leur paraissait déjà parfaitement normal de défendre leur environnement au détriment de ceux qui habitent dans les villes voisines ou à la campagne. Le citoyen balnéaire reproduirait-il le même mépris que le citadin à l'égard des ruraux et des banlieusards ?
On le sait, ce problème des centres-villes n'est pas inhérent au littoral et, ici comme ailleurs, il faudra probablement renouveler toute l'offre de transports publics et privés, la rendre enfin totalement confortable, rapide et attractive, et mieux l'adapter à la saisonnalité. Il faudra aussi réinventer et déployer les clubs de surf dont les installations pourraient accueillir davantage de planches et permettre à plus de membres de privilégier le vélo ou la marche. Et plaisir déjà ancien, prendre une petite douche pour se rincer, puisqu'elles ont pratiquement disparu des plages françaises suite aux sécheresses successives même dans les régions toujours pluvieuses (mais la pluie n'aide pas à boucler les budgets des municipalités depuis la suppression de la taxe d'habitation).
Mais ces villes et bourgs fortement urbanisés de la Côte basque ont leurs contraintes que les plages des anciennes côtes sauvages ne connaissaient pas. Et pourtant, des zones qui demeuraient hors de tout véritable centre-ville comme les plages d’Anglet, sont devenues récemment des villes payantes comme les autres.
Des congés payés aux plages payantes : la fin d’une époque
Ainsi sur la Côte basque, seuls sont gratuits le parking de la plage de la Milady à Biarritz, les quartiers d'Acotz et d'Erromardie à Saint-Jean-de-Luz et le village de Guéthary. Pourtant celui-ci a supprimé 150 places et rendu impraticable pour les deux mois d'été son centre-ville avec des sens interdits sauf véhicules autorisés que personne n'a respecté. Pour surfer, à Parlementia ou accéder à Cenitz, il faut emprunter de longs itinéraires de contournement si l'on veut vraiment être très scrupuleux du code de la route local et estival. Pour le bilan carbone, on repassera.
Ajout du 22 août 2024 : la mairie de Saint-Jean-de-Luz chercherait désormais à faire de même pour le quartier d’Acotz afin de préserver la tranquillité des riverains. Et les deux dernières plages gratuites de Biarritz, la Milady et Ilbarritz sont passées payantes face au report d’affluence de sa voisine immédiate Bidart (Ilbarritz est à cheval sur les deux communes).
Dans ces conditions, les presque cinq kilomètres de littoral angloy ne pouvaient guère résister à cette mode de la régulation. Car s’il y a trente ans, on pouvait encore se garer librement sur la terre battue qui recouvrait l’ancienne piscine de l’établissement de bains et surtout près des dunes de sable, l’accès aux plages est devenu payant à Anglet. Si on ne perçoit plus les vestiges d’une côte sauvage dont la beauté a attiré de Buster Keaton aux meilleurs surfeurs australiens, l’endroit gardait cet esprit de liberté malgré les inévitables pics de fréquentation du mois d'août. On se garait dans le sable, on s'enlisait jusque dans les années 1980, mais le charme des lieux était encore intact. Ce littoral a depuis été fortement anthropisé (façonné par la main de l'homme), des parkings ont été conçus (en bitume) et de grandes pelouses, délaissées par le public car sans vue sur l'océan. Enfin, un parc ornithologique a été sanctuarisé. Mais dans le même temps la construction, il y a plus de quinze ans, d'une promenade en béton « a achevé de couper le cycle du sable dunaire » nous confirme Aymeric Bayle, président de l'association SOS Littoral Angloy. Des blocs de béton sur trois kilomètres qui auraient accentué l'estran – le dénivelé du rivage –. Une érosion artificielle (à cause des digues) accentuée par la raréfaction dans les années 1990 puis l'arrêt des campagnes de réensablement par bateaux entre 2004 et 2010. Enfin, une méthodique chasse aux vans aménagés (qui ont le droit de stationner comme tout véhicule de tourisme) les a peu à peu poussés dans des parkings réservés aux camping-cars (et déjà payants).
Malgré tout, Anglet était la dernière commune de la Côte basque à pratiquer la gratuité de tous ses parkings du littoral pour les véhicules de tourisme non habitables. La ville des forêts et des golfs (qui était aussi celle des villages de vacances... et des cinq campings désormais tous disparus) ferme le ban après Bidart, il y a deux ans. Gratuité partielle pour les résidents de la commune, et paiement dès la première minute pour tous les autres automobilistes. Si l'on ajoute l'inefficacité du réseau de transports en commun (impraticable en longboard et sans suffisamment d'abribus) et la dangerosité des pistes cyclables en pointillé sur la commune et livrées aux embardées des SUV au moindre rond-point, on obtient des plages désormais payantes. A commencer pour les familles qui ont le plus besoin de la voiture car elles vivent de plus en plus loin dans un contexte immobilier hyper tendu. Prévu jusqu'au 31 octobre cette année avec des tarifs atteignant 35 € dans la fameuse zone rouge de la Chambre d'Amour (10 € la journée ailleurs), le dispositif confié à un exploitant privé devrait être relancé au 1er mai en 2024 (car les dimanches et les jours fériés sont inclus).
Surtout, les abords des plages les plus isolées ne sont même pas viabilisés et ce sont des places à cheval sur des margelles de trottoir entre la route et la terre sablonneuse qui font office d’emplacements de stationnement. Se dirige-t-on vers une bitumisation supplémentaire et inutile pour rendre légal le stationnement payant ? Sollicité, le maire Claude Olive n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Qu'il était bon le temps où l'on pouvait surveiller les vagues depuis son van, à même les digues. Ici, en 1972, Miki Dora à Anglet et, à gauche, son van blanc et vert. Photo : SOS Littoral Angloy.
La Petite Chambre d'Amour à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) autour de 1950. Photo : SOS Littoral Angloy..
La Madrague et l'Océan à Anglet dans les années 70. Photo : SOS Littoral Angloy.
Les Landes, les dunes et les maires
La fiêvre réglementaire pourrait également se poursuivre dans des parties encore plus calmes du littoral hors-saison. Dans les prochaines années, les Landes vont connaître un fort développement et un étalement urbain même dans l'environnement immédiat du trait de côte. La plupart des résidents et des municipalités ont compris qu'il fallait respecter les dunes, fussent-elles d'origine humaines comme celles de Saint-Girons entre autres, et ont créé des chemins qui contournent les crêtes et canalisent les flux estivaux. La mairie d'Ondres a ainsi décidé du recul de près de 450 mètres du parking de la plage, revégétalisant les anciens lieux de stationnement mais sans pour autant les remettre à l'état sauvage. Un soucis de protection qui semble parfois vouloir entraver les accès pratiques à la plage. Ainsi le président du Groupement d’Intérêt Public Littoral, Henri Sabarot le déclare : « Pour 2030 [il faudra] la renaturation des sites, une place donnée aux cyclistes et aux piétons, qu’on se gare loin. » Comme une réserve où l'on se rendrait exceptionnellement et non quotidiennement. Un « plan plages » est également en préparation entre Moliets en Contis où les zones encore libres devraient être aménagées pour lutter... contre le camping sauvage. Ou comment potentiellement couler du béton pour défendre la nature.
Du côté du Penon (Seignosse) dans les Landes, ce sont également des voies sans issues qui permettaient d'accéder aux spots via des chemins dunaires qui ont été privatisées par les nouveaux sens interdits « sauf riverains ». Des amendes de 135 euros supprimant 4 points de permis de conduire ont été dressées (sans procédure de flagrant délit). On peut s'interroger sur ce qui détermine juridiquement la notion de riverains et vu le développement des locations saisonnières, ce n'est certainement pas la plaque d'immatriculation qui peut faire foi. Cependant, de facto, les chemins deviennent des voies d'accès privés.
Vive la Bretagne libre !
Si les plus de 1700 kilomètres de côte donnent des airs d'eldorado au littoral breton, et que la pratique explose (près de 80 000 pratiquants selon la Fédération Française de Surf) tout ne va pas sans heurts non plus chez les Armoricains, par Toutatis ! Saint-Malo intramuros a inévitablement dû construire des parkings payants sur ses bassins portuaires pour accéder à la vieille ville. Cependant, le reste de la côte bretonne demeure facilement accessible. Mais la tendance à la restriction s'installe : la chasse aux camping-cars et aux vans y est courante et ceux-ci sont souvent relégués dans des sortes de quasi terrains-vagues comme, par exemple, à la pointe du Groin près de Cancale.
Sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère où se trouve le célèbre spot de la Palue, les surfeurs affluent sur des chemins encore déserts il y a deux décennies. Et ça coince parfois dans les ruelles du hameau. Comme un réflexe du passé face à ces hordes de chevelus qu'on confond peut-être avec les Wisigoths, il a été décidé d'installer une barrière en été pour fermer le parking historique seulement accessible aux pompiers et aux écoles de surf car selon le maire Patrick Berthelot « elles sont acréditées » (source France 3 Bretagne)*. Aux familles et à ceux qui veulent venir plus tôt ou partir plus tard d'utiliser un petit parking éloigné de 500 mètres et un autre éloigné d’1,5km desservi par une navette. Et tous sont fermés de 22h à 7h rendant impossibles les surfs de l’aube et du crépuscule. Un maire qui, on le voit, a joué à fond la carte offerte par la loi de 2021 sur les espaces protégés. Un collectif de plus de quatre cents personnes s'est ainsi mobilisé pour refuser ce nouvel aménagement avec, à sa tête, le champion local Sam Lagadec. Le surfeur nous confie que « derrière la loi se cache des intérêts un peu moins nobles que la défense de l'environnement mais davantage la protection de la quiètude de riches riverains qui y ont acquis des propriétés et qui voient d'un sale œil ce déferlement de surfeurs à l'année. Et d'ajouter : aller surfer à vélo, c'est quasiment du suicide car les ruelles du hameau sont étroites. » Malgré la mobilisation des usagers des plages, à commencer par les surfeurs locaux, les modifications ont été imposées. Pour Sam, il y a eu un simulacre de consultation. « Pour autant, on aimerait créer un dialogue en amont des décisions, plaide-t-il. On veut y participer, pas qu'on nous explique les modifications a posteriori. Et même que ce soit bien plus rigoureux avec des comptages et des vraies statistiques. » Pourtant en septembre 2023, une étude d'impact vient de renforcer l'impérieuse nécessité de ces nouvelles installations contraignant à marcher pour se rendre au spot.
« Trois réunions citoyennes et un questionnaire sur Internet » s'insurge Sam Lagadec. Ou comment des habitants du cru, disséminés sur plusieurs communes jusqu'à Brest, voient leur mode de vie régi par le maire d'une seule.
Ajout du 22 août 2024 : confinant au ridicule, la mairie de Tréguennec (Finistère) a interdit non seulement la baignade mais toute activité nautique dont le surf au motif de la dangerosité de sa plage et de l’absence de surveillance. L’arrêté a provoqué la colère des habitants et a été attaqué au fond au tribunal administratif.
En revanche, les parkings de la Côte sauvage de la presqu'île de Quiberon (Morbihan) – où a été créée en 2022 la première réserve naturelle de vagues entre Port Blanc et Port Bara – sont toujours gratuits et dans le respect de l'environnement naturel, à savoir sans aucune artificialisation des sols. C'était déjà en 1936 la première zone côtière à être protégée en tant que site pittoresque du Morbihan avant d'intégrer pour près de 200 hectares le Conservatoire national du littoral. La culture marine bien plus ancrée en Bretagne que dans les anciens marais asséchés des Landes et de Gascogne, terre avant tout rurale et forestière (le président du GIP Littoral est également président de la Fédération de chasse de Gironde...), a sûrement contribué à cette préservation nuancée de l'espace de vie où se cotoient des publics très différents et où se transmet une culture du respect et du partage simple et évidente. Mais on le voit, dans le Finistère, les réactions sont pour le moins très précautionneuses à l'égard de la surfréquentation des saisons estivales de 2021 et 2022, et elles modifient déjà en profondeur la relation à ce bien commun qu'est la plage française.
A l'opposé de ces exemples pourtant inscrits dans le temps et l'histoire, se profile une limitation censitaire du littoral, offert à ceux qui ont les moyens de payer le stationnement ou le privilège d’y habiter. En droite ligne avec les nombreuses atteintes aux libertés de circuler développées lors de la crise sanitaire, et après son absurde version dynamique, la plage payante risque fort de s’imposer en France. On l’a toujours écrit : le surf est un sport de rois.
A Port-Bara, sur la Côte Sauvage de Saint-Pierre Quiberon, la lande et le site ont été conservés dès 1936. C'est dans cet esprit, que les spots y ont été protégés dans la première réserve naturelle de vagues française. Pour autant, les parkings y demeurent gratuit et sans bitume. Photo : EL.
Le spot de la Palue sur la presqu’île de Crozon (Finistère) a vu ses aménagements s’éloigner pour lutter contre la fréquentation estivale. Au risque de rendre la vie impossible aux locaux. Photo : S. Lagadec.
Aux abords de la plage des Dunes à Anglet, un étrange signe est apparu en 2023 devant les margelles de trottoir. Si les scientifiques excluent une origine extra-terrestre, les habitués de la plage (qui ne sont pas forcément riverains) craignent une viabilisation à coups de bitume déversé sur ce qui reste de parcelle dunaire. Photo : EL.
*à ce sujet, il n'est pas certain que le maire ait la compétence pour donner des autorisations concernant l'enseignement du surf. Le pouvoir de police administrative spéciale que lui confère la loi concernant les activités nautiques se limite à des impératifs de sécurité, de tranquilité et de salubrité. Ainsi, le 12 juillet 2023, la mairie de Capbreton a vu ses autorisations aux écoles de surf suspendues en référé par le tribunal administratif de Pau. Le juge a estimé que la loi ne permettait pas au maire de soumettre l'enseignement du surf à une autorisation préalable. Ajout du 22 août 2024 : La décision au fond de juillet 2024 est a confirmé l’atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et a annulé l’arrêté.