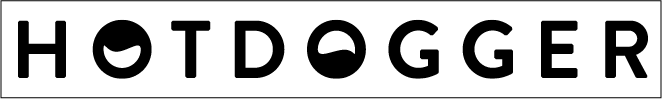STÜSSY PIMPE DIOR
Shawn Stüssy, le shaper et le créateur de la marque qui a tant bouleversé les codes de la mode streetwear dans les années 80 et 90, est de retour. Ou comment une signature surf est devenue l’emblème et la référence d’une mode ultra urbaine. Et c’est en majesté puisqu’il signe une collaboration inattendue avec Dior à l’invitation de Kim Jones présentée à Miami en marge d’Art Basel, la foire d’art contemporain. C’est dire si cette collection est marquée du sceau de la créativité artistique avec un savoir-faire digne des ateliers de surf et de sérigraphie. Un dernier twist a été de faire appel à des maîtres japonais de l’impression sur textile. Retrouvez ici le film de cette association ainsi que le portrait que nous lui avions consacré dans notre 10e édition (hiver 2017/2018).
Photo : IVAN TERESTCHENKO
Par Momal Zerouali
Shawn Stüssy cultive la discrétion. Depuis quelques années, il vient à Guéthary profiter de l’automne pour surfer. Le surfeur et fondateur de la marque éponyme Stüssy renoue avec cette réserve de la première heure lorsqu’il était un shaper de l’underground de la scène surf californienne. Après avoir été dans la lumière pendant quasiment deux décennies entre 1989 et le début des années 2000, Shawn Stüssy a désormais le temps d’organiser sa journée en fonction du surf après s’être exclusivement consacré à sa marque, de Los Angeles à Tokyo en passant par New York, Londres et Paris. Aujourd’hui, les vagues sont gigantesques à Guéthary. Une houle entre quatre et cinq mètres, générée par l’ouragan Ophélia qui sévit au sud de l’Irlande après un voyage à travers l’Atlantique, bombarde la côte. « La houle est solide et bien rangée, » observe le Californien depuis le promontoire qui surplombe la vague de Parlementia. « C’est un peu trop gros pour moi, » avoue-t-il humblement. « Mais ce soir, avec la marée descendante et le vent offshore moins fort, il y en aura de très belles à prendre. »
Le matin de notre entrevue, Shawn Stüssy est allé flâner au marché et dans les rues de Saint-Jean-de-Luz. Il en a ramené un délicieux pastis landais qu’il partage amicalement dans la plus pure tradition du goûter à la française en cette belle fin d’après-midi d’été indien. Le designer américain n’aime pas l’exercice de l’interview, il n’en donne que très rarement. Il se justifie en disant qu’il parle souvent trop et qu’il a toujours peur que ses propos soient déformés ou mal interprétés. Son histoire, il ne sait comment la raconter et par où commencer. « Mais que veux-tu savoir au juste ? » demande-t-il quelque peu circonspect et surpris de l’intérêt qu’il peut encore susciter, lui qui n’est plus aux commandes de la marque qu’il a fondée voilà plus de vingt ans déjà. Car si Stüssy est devenue un label culte de la street culture, c’est bien dans le surf qu’elle trouve ses racines. En terme d’image, Stüssy était dans les années 90 ce que représente aujourd’hui Supreme, label né sur la scène skateboard new-yorkaise, pour devenir une marque à la renommée internationale.
Formé à bonne écoleC’est à Laguna Beach, au milieu des années soixante, que Shawn Stüssy débute sa belle histoire avec le surf. Bricoleur et doué de ses mains, le jeune californien fabrique ses propres planches à partir de longboards récupérés. « Le film Gidget qui a eu beaucoup de succès en Californie à la fin des années 50 a attiré de nombreux nouveaux pratiquants. Mais la plupart d’entre eux, comme ma grande sœur par exemple, n’ont pas continué, c’était une mode et beaucoup de longboards ont été délaissés dans des garages. Donc je les récupérais, j’enlevais la fibre de verre et les dérives. À cette époque, nous étions à un tournant, les planches devenaient de plus en plus courtes. Je les shapais avec un surform (petit outil qui sert à dégrossir un pain de mousse, NDLR), c’était vraiment tout ce que j’avais comme outil. » À 14 ans seulement et ne sachant pas comment glacer les formes qu’il façonne, il a la chance d’avoir pour professeur d’éducation manuelle et technique le légendaire shaper Bob « Ole » Olson - 86 ans aujourd’hui et toujours en activité sur l’île de Maui - qui lui apprend les rudiments de la fabrication de planches de surf. Ensemble, ils en fabriquent une cinquantaine. À l’âge de 15 ans, Stüssy devient shaper de métier. Il travaille notamment pour le surf shop Brotherhood où son apprentissage s’accélère entre 1973 et 1979, alternant avec des saisons à la montagne où il enseigne le ski. Déjà, les fondements d’une culture crossover entre la mer et la montagne germent dans l’esprit du jeune Stüssy. En 1978, à l’âge de 25 ans, il décide qu’il est temps de devenir un adulte et de sérieusement se mettre au travail. En ces années punk, les logos des marques de surf n’ont pas changé d’un iota depuis les années soixante. « On avait encore ces logos géométriques, rectangulaires ou en losanges comme Dewey Weber, Renny Yater, Gordie, etc., tous ces labels que nous redécouvrons aujourd’hui. Je me disais “ce sont de vieux gars, peut-être que je devrais voler de mes propres ailes”. Même si l’Australien Geoff McCoy arrivait avec de nouvelles idées et un logo accrocheur à Newport Beach d’où j’étais originaire. » A cette époque, la cité calme du sud de Los Angeles n’a pas un shaper majeur qui se démarque : des places sont à prendre. Shaun Stüssy saisit sa chance. « Mes idoles comme Mike Diffenderfer ou Dick Brewer étaient considérés comme des shapers hawaiiens même si Mike était originaire de San Diego. À la fin des années 70, on voit surtout des Lightning Bolt, des Tom Parrish, des Brewer, tous des Hawaiiens. McCoy avait un énorme logo et moi je signais toujours mon nom de manière très discrète en petit sur la latte. Les vieux shapers de Brotherhood me prenaient pour un egocentrique et me disais “tu dois écrire ton nom bien visible sur la planche” et je leur disais que j’étais encore trop jeune et avais besoin de plus d’expérience pour prétendre le faire. » En signe de douce révolte envers ses aînés et dans une attitude délibérément punk, Stüssy dessine le logo de sa marque qui, plus de quarante ans après sa création, reste toujours une référence en matière de graphisme copié à de nombreuses reprises (cf. la série télévisée Malcolm dans les années 90) et dont une police d’écriture s’est inspirée. Le surf n’est toujours pas considéré comme un sport, les circuits de compétition commencent à peine à voir le jour. Peu importe, Shaun Stüssy n’y prête de toute façon aucun intérêt. « Ma génération ne s’intéressait pas à la compétition. Pour moi, c’était déjà quelque chose qui pouvait tuer le surf. Toute ma vie, j’ai toujours cherché à ne pas être jugé et refusé de faire du sport de compétition. C’est aussi pour ça que nous sommes devenus des surfeurs car c’était une contre-culture. » À travers sa marque, Stüssy a constamment voulu embrasser cette identité contre-culturelle du surf en mettant sa créativité, sa spontanéité et son authenticité au-dessus de l’aspect sportif et industrielle du surf. L’univers du créateur californien s’articule autour de la musique, de l’art, de la mode, du travail artisanal et d’une philosophie épicurienne du surf. Si pendant près de deux décennies, le surf s’est développé à travers une vision sportive de sa pratique avec la professionnalisation du surf et ses stars emmenées par Tom Curren, Tom Carroll, Martin Potter et plus tard Kelly Slater, Stüssy n’a jamais voulu faire de son label une marque de sport. Il se réjouit aujourd’hui de voir que le surf est revenu à une image plus proche de ses racines même s’il n’est pas dupe et que là aussi, certaines marques ont flairé le bon filon. « Pour moi, il y a deux cultures séparées entrecroisées. Il y a la partie professionnelle qui s’est construite autour d’une industrie depuis presque quarante ans avec de grandes compagnies et tout ce que ça implique aujourd’hui avec le surf aux Jeux olympiques et une vision très sportive notamment avec l’arrivée des surfeurs brésiliens. C’est devenu un peu comme du football dans l’approche. Mais heureusement, ces quinze dernières années, une culture alternative a vu le jour et de nouvelles opportunités pour faire des affaires grâce à des gars comme les frères Malloy, Jack Johnson et son film Thicker Than Water, les artistes du Beautiful Losers, Thomas Campbell et ses films Sprout et The Seedling… c’étaient les débuts de ce mouvement alternatif. C’était cool et à partir de là, de nombreux surf shops ont commencé à vendre d’autres produits que ceux des grandes marques ou des shapers connus même si aujourd’hui ça devient un peu trop cliché. Car cette culture dite alternative a trouvé elle aussi des débouchés industriels puisqu’on a aussi vu éclore des boutiques, des compétitions s’organiser, des films qui sont produits autour d’elle… »
De Laguna Beach à New York
Dans son style, la marque Stüssy est, dans les années 90 un label alternatif dans sa démarche. Shaun Stüssy se consacre de plus en plus à sa marque et délaisse quelque peu le shape ne fabriquant plus qu’une trentaine de planches par an. Ainsi, il avoue être passé à côté de cette époque des petites planches performantes, non pas qu’il ne soit capable de les réaliser, mais d’une certaine manière, il a gardé le goût pour ces belles formes des années 70 aux courbes effilées qui font encore aujourd’hui une des spécificités des designs de Stüssy. Il n’oublie pas pour autant qu’il a shapé des planches pour le Californien Jeff Booth, surfeur professionnel du circuit ASP à la fin des années 80 : « c’était un gamin du quartier, mais dès qu’il est devenu pro, je lui ai conseillé d’aller voir Town&Country. Je lui ai shapé des planches jusqu’à ses seize ans mais j’étais juste un shaper dans un garage, je ne pouvais pas l’approvisionner en planches comme les grandes marques le faisaient. Je n’avais pas vraiment de team à cette époque. Ce n’est que plus tard lorsque j’ai vendu la marque qu’il y a eu un team avec des surfeurs et des skateboarders. » Au début, lorsqu’il développe sa marque, Shaun Stüssy la monte dans un esprit de fraternité et fabrique des planches surtout pour les potes du quartier ou de la plage.
En 1980, les Sud-Africains Michael Tomson et Joel Cooper débarquent à Laguna Beach avec l’ambition de créer une marque de surf, Gotcha, qui a donné un coup de fouet à la mode surf moribonde du milieu des années 80 et 90. Shaun Stüssy crée le premier logo de cette nouvelle marque et shape aussi des planches pour un gamin qui commence à faire des siennes sur le circuit professionnel mondial, un certain Martin Potter. « Je lui ai shapé un twin-fin et il a gagné sa première compétition pro avec. Il est devenu Martin Potter. Donc je me suis retrouvé à fréquenter Gotcha, on m’avait chargé de concevoir les boardshorts (on appelait ça des trunks à l’époque, NDLR) et je faisais des planches à côté. Un jour Tomson m‘a demandé d’arrêter ma marque pour me consacrer exclusivement à Gotcha. Je me suis dit que ça n’allait pas le faire. J’étais capable de concevoir des vêtements, ce n’était pas pour le faire pour un autre exclusivement. C’étaient des gens très cools, mais je ne pouvais pas lâcher ma marque comme ça. » Au début des années 80, les salons professionnels de surf commencent à voir le jour. Shaun Stüssy a la chance de rencontrer à Laguna Beach les deux fondateurs de ce qui va devenir plus tard SurfExpo dans les années 90 et 2000. Ils entrent en contact avec lui après avoir vu la popularité de ses planches de surf auprès des jeunes du coin. Les deux organisateurs cherchent de nouvelles marques pour dynamiser leur salon et lui proposent un stand gratuit. Stüssy se retrouve à Long Beach dans ce nouveau concept que sont les salons professionnels de surf. « La veille, avec un ami, on s’est fait des t-shirts avec le logo Stüssy dessus dans le style Alva, en guise d’uniformes pour le salon. J’ai garni le stand avec des planches. Trois jours plus tard, j’en avais vendu 24. Puis les gens se sont intéressés aux t-shirts qu’on portait, on ne comprenait pas vraiment, j’en demandais alors 8 $... à la fin du salon j’avais signé des commandes pour un millier de t-shirts. » Six mois plus tard, Shaun Stüssy se lance dans la production et propose trois modèles de t-shirts sans véritable plan pour éventuellement un jour lancer une collection de vêtements. De fil en aiguille, il récupère des chinos de la guerre du Vietnam de couleur kaki dans des surplus de l’armée à partir desquels il fabrique ses premiers boardshorts, aidé par sa mère et sa tante à la couture. Les produits se démarquent de la tendance fluo dans les salons pros et commencent à définir le style singulier de Stüssy. Entre 1981 et 1986, c’est en toute innocence et sans objectif précis qu’il s’amuse à créer toutes sortes de vêtements qui suscitent de plus en plus l’intérêt d’un public toujours en quête de nouveauté et de style. Outre les vêtements, Shaun Stüssy dirige tout, de la création des publicités à la photographie et la stratégie marketing. En 1986, il s’associe avec un ami, Frank Sinatra Jr. (aucun lien de parenté avec le célèbre crooner), un comptable qui a une meilleure connaissance du marché. Stüssy devient une entreprise et se lance désormais dans la mode. Tout va s’enchaîner très vite et au début des années 90, le shaper se retrouve au milieu de rappers, de Dj new-yorkais, de musiciens de reggae, de skateboarders et la marque Stüssy prend de plus en plus un virage street culture sans que, encore une fois, tout cela soit prémédité. C’est à travers ses voyages à New York, Tokyo, Londres, Paris et ses rencontres dans les milieux de la musique et du hip hop que se forge l’identité de la marque Stüssy. « Tout cela est arrivé naturellement comme une forme d’hybridation de la marque. Je me suis retrouvé à dessiner toutes sortes de fringues, je me souviens avoir notamment crée douze vestes en cuir sur lesquelles j’avais écrit les noms des artistes phares de la marque et que j’avais envoyées dans des shops à New York, Tokyo, Londres, Los Angeles… puis je me suis mis à en fabriquer le double et ainsi s’est forgée la notoriété de la marque. C’était la tribu internationale de Stüssy qui se développait. Moi je me baladais dans des expos de Keith Haring, de Basquiat, c’était juste ce que je faisais qui inspirait la marque, sans calcul. »
Le parrain de la street culture
Parti d’un petit garage, Shaun Stüssy devient le président d’une marque mondialement connue recevant les louanges de la rue qui l’intronise comme le parrain de la street culture. Autant dire que ce genre de titre honorifique à de quoi effrayer un Shaun Stüssy qui n’aime pas trop être mis dans une boîte. « Là je me suis dit “mais de quoi parlent-ils ?”. Je me suis senti mal à l’aise. Je me retrouvais classé dans une catégorie alors que j’avais toujours lutté contre ça. Presque aussitôt qu’on a nommé ce que je faisais, je me suis dit qu’il était temps de partir. » Sans le vouloir, Shaun Stüssy a pavé la voie de ce qu’allait devenir la street culture et sa mode inspirant même un de ses meilleurs potes, James Jebbia, fondateur de la marque Supreme. Les deux marques ont partagé des boutiques durant plusieurs années à New York et Los Angeles et sont à l’origine de plusieurs collaborations. Avec ses racines issues du skateboard, Supreme se présente comme la digne héritière de Stüssy lorsqu’en 1996 le surfeur californien décide de vendre sa marque à son principal associé. « C’est très intéressant, j’ai eu mes vingt années, James (Jebbia) a eu les vingt suivantes. Dans la même double décennie, il y a eu aussi Colette (qui a fermé fin 2017). James a vendu la moitié de sa compagnie à une compagnie financière et même si Stüssy et Supreme continueront d’exister, de quoi sera fait l’avenir ? »
Aujourd’hui, Shaun Stüssy vit une existence paisible entre Kauai, la Californie et l’Europe, shapant ici et là des planches en très petite quantité pour quelques privilégiés dans la plus stricte intimité sous son label S-Double. Il développe secrètement son art, trouve son inspiration dans les voyages et surfe à l’envi. Après plusieurs décennies dans les affaires, il revient à ce qu’il a été plus jeune, un shaper-surfeur anonyme se laissant porter au gré des houles, des saisons et des rencontres comme pour boucler la boucle. Face à la vague de Parlementia, ce sont plus de cinquante ans de surf qu’il contemple. « Qui sait ? L’histoire n’est peut-être pas encore finie » glisse-t-il avec un air malicieux.